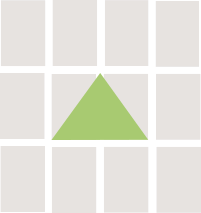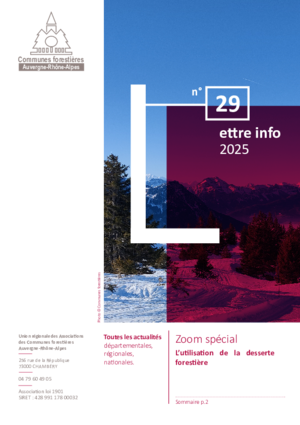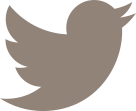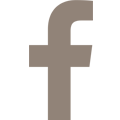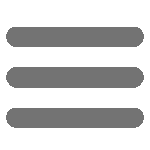
Forêt publique


Focus sur l'utilisation de la desserte forestière
Cofor AURA | 17 Février 2025
DESSERTE
L’accessibilité des massifs forestiers est un sujet indissociable de la gestion forestière. Diverses voies permettent de se déplacer à l’intérieur des massifs forestiers et de les relier au reste du territoire où la population et les entreprises de la filière forêt-bois sont présentes.
Plusieurs guides sur la desserte forestière et son utilisation ont été réalisés par les Communes forestières. Les plus récents sont les suivants, disponibles en version numérique sur simple demande, ou en téléchargement sur ce site :
- Voirie et exploitation forestières, Communes forestières d’Ardèche, 2022 ;
- Voirie forestière : Guide des droits et obligations des élus, FNCofor, 2021 ;
- Voirie forestière, Communes forestières du Puy-de-Dôme, 2021.
Les collectivités, au cœur de la desserte forestière
Bien que la forêt soit majoritairement détenue par des particuliers, les collectivités sont les acteurs principaux au cœur du maintien et du développement d’un réseau de desserte forestière efficient. Ce réseau permet notamment l’approvisionnement de la filière forêt-bois à laquelle tiennent les élus locaux.
Une part importante de la desserte forestière est constituée des domaines public et privé des collectivités. Ces dernières sont par ailleurs les premières à investir dans de nouvelles infrastructures. Les dépenses sont conséquentes : études préalables (dont les schémas directeurs de desserte forestière), investissements pour de la création, dépenses d’entretien, etc. Des dotations et subventions existent, mais elles ne couvrent pas l’intégralité des besoins, et une part d’autofinancement est toujours nécessaire.
Par ailleurs, la desserte forestière est rarement réservée aux seuls forestiers. Chaque utilisateur à ses attentes propres, pas toujours compatibles. Les élus locaux sont alors confrontés à la prévention et à la résolution de conflits d’usage.
Dans l’ensemble, les élus locaux ont une place centrale avec plusieurs rôles complémentaires : médiateurs, aménageurs de territoires, propriétaires forestiers, maître d’ouvrage et garant de la sécurité publique.
Quelques notions clés
Les forestiers utilisent un vocabulaire basé sur l’usage de la desserte : routes forestières pour la circulation des engins et camions de transport, pistes pour aller au cœur des massifs et déplacer les bois jusqu’aux places de dépôts, et cloisonnements pour les passages matérialisés à l‘intérieur des parcelles forestières pour l’abattage, le débardage et divers travaux.
Les forestiers utilisent un vocabulaire basé sur l’usage de la desserte : routes forestières pour la circulation des engins et camions de transport, pistes pour aller au cœur des massifs et déplacer les bois jusqu’aux places de dépôts, et cloisonnements pour les passages matérialisés à l‘intérieur des parcelles forestières pour l’abattage, le débardage et divers travaux.
Les élus doivent quant à eux raisonner en fonction du statut juridique de la voirie. Ces statuts déterminent les droits et devoirs de chacun. Ils sont définis par le Code de la voirie routière et le Code rural et de la pêche maritime.
En cas de récolte forestière, le transfert de propriété des bois s’accompagne de transferts de responsabilité. En lien avec l’utilisation d’une voirie, il est important pour le propriétaire du chemin de trouver qui est le donneur d’ordre du chantier, qui pourra mettre en relation avec les responsables à chaque étape (abatteur, débardeur, transporteur…). Le propriétaire forestier ou l’entreprise identifiée sur le terrain sont les premiers interlocuteurs à privilégier, avec courtoisie, pour savoir qui contacter.
Afin d’encourager les bonnes pratiques, plusieurs territoires ou entreprises s’engagent dans des dispositifs volontaires favorisant les échanges entre élus locaux et donneurs d’ordre forestiers. Leur nom peut varier : « demandes de renseignements », « Modes opératoires », « Chartes des bonnes pratiques » ... Ils sont le plus souvent intégrés aux démarches qualité des entreprises (coopératives notamment) ou animés par les Communes forestières et Fibois en lien avec une intercommunalité ou une Charte forestière de territoire. Le principe est simple : un chantier annoncé en amont avec les coordonnées directes des parties prenantes sera moins conflictuel car mieux anticipé.
Ces démarches volontaires viennent compléter les lois et règlements en vigueur relatifs à l’utilisation des voies et chemins (cf. paragraphes suivants) ou à la gestion des chantiers : déclaration des chantiers de coupe ou débardage mécanisés de plus de 500 m3, DT ou DICT pour les travaux à proximité de réseaux, permissions de voirie, déclarations préalables de coupes, etc. Des démarches sont en cours pour faciliter l’appropriation par les entreprises de tous ces aspects. C’est par exemple le cas avec la plateforme « Forêt en Règle » de Fibois, et un module complémentaire en cours de développement, financé par les Communes forestières avec le soutien de la DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes.
Voies communales
Les voies communales sont classées dans le domaine public routier et sont affectées à la circulation générale. L’entretien de ces voies est une dépense obligatoire des communes. En contrepartie, la longueur des voies communales est un des critères pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement des communes. Par définition, les principes de gratuité et de liberté de circulation s’appliquent. Ainsi, il est illégal de demander une caution aux utilisateurs, forestiers ou autres. Cependant, le Code de la voirie routière permet d’imposer aux entrepreneurs ou aux propriétaires desservis des contributions spéciales en argent ou en prestation en nature dès lors que la circulation entraîne des détériorations anormales, ou que la voie est dégradée par des exploitations (y compris de forêts). Les contributions spéciales doivent être proportionnées à la dégradation causée. À défaut d’accord amiable, elles sont fixées annuellement sur la demande des communes par les tribunaux administratifs.
La fermeture d’une voie communale nécessite un arrêté municipal ou préfectoral motivé soit pour des motifs de sécurité, soit pour des motifs liés à la protection de l’environnement. A noter qu’un arrêté ne peut pas cibler les forestiers uniquement : si une limitation à 15 tonnes est nécessaire, elle doit être applicable que ce soit pour du bois, du lait ou des ordures ménagères.
Pour veiller à ce que la circulation soit toujours possible, une permission de voirie est nécessaire pour les activités donnant lieu à emprise, ou un permis de stationnement dans les autres cas. Cette règle est davantage mise en œuvre sur les voies départementales que sur les communales.
Chemins ruraux
Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune. Ils sont affectés à l’usage du public, et ne sont pas classés en voies communales. Un chemin rural le reste tant qu’il n’est pas déclassé. L’entretien des chemins ruraux n’est pas obligatoire. Toutefois, la commune peut être tenue comme juridiquement responsable des dommages liés à un défaut d’entretien si elle a accepté d’assurer la viabilité d’un tronçon. Comme pour les voies communales, la circulation est libre mais des contributions spéciales peuvent être imposées en cas de détérioration anormale ou de dégradations liées à des exploitations.
Les coûts d’entretien des chemins ruraux peuvent être pris en charge par la commune. Bien que ce soit peu utilisé, les textes permettent aussi d’accepter une souscription volontaire ou la création d’une taxe spéciale recouvrée comme un impôt direct auprès des habitants ou propriétaires desservis.
Dans le cadre de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet peuvent fermer un chemin rural à la circulation publique par arrêté soit pour des motifs de sécurité, soit pour des motifs liés à la protection de l’environnement. Ces arrêtés ne peuvent cibler les seuls forestiers.
Voies privées
Hors domaine public routier et chemins ruraux, il existe un réseau de voies régies par le droit privé destinées à la desserte locale et à l’exploitation des fonds ruraux. En l’absence de signalisation, ces voies sont présumées ouverte à la circulation si elles sont carrossables. Leur entretien est du ressort du ou des propriétaires, qui décident d’ouvrir ou non les voies à la circulation publique (pour une commune, par simple délibération). Un arrêté du maire ou du préfet peut également s’imposer, soit pour des motifs de sécurité, soit pour des motifs liés à la protection de l’environnement.
Lorsque les voies servent à la communication entre plusieurs fonds ou à leur exploitation, et desservent plusieurs propriétés, on parle de chemins et sentiers d’exploitation. Leur usage est commun à tous les intéressés. Les ayants-droits des propriétaires (acheteurs de coupes, titulaires d’un droit de chasse…) ont le droit de circuler au même titre que les propriétaires sous réserve de restrictions stipulées dans les clauses d’un contrat (vente de coupe, bail de chasse…). Tous les propriétaires concernés sont tenus de participer à l’entretien du chemin, au prorata de l’usage, sauf renonciation à utiliser le chemin.
Servitudes
Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, peut réclamer à ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. On parle alors de servitude légale, qui s’impose aux voisins. Une convention peut être mise en place pour fixer les conditions techniques et financière d’application.
Si une propriété n'est pas enclavée, l'accord du voisin est toujours nécessaire pour obtenir un droit de passage sur son terrain (en cas de difficulté d'accès par les sentiers classiques par exemple). Un accord amiable écrit doit être trouvé et préciser l'emplacement du droit de passage, son mode d'exercice et le montant de l'indemnité éventuelle. Dans ce cas, la servitude est dite conventionnelle.
LETTRE INFO

Dernières nouvelles
Bois énergie Transition énergétique
Bois énergie ou biogaz, quel avenir pour nos réseaux ?
Cofor AURA | 25 Mars 2025
Inauguration de plantations en forêt communale de Porte-de-Bonnevaux
Cofor 38 | 25 Mars 2025
Pédagogie et accueil du public
La Forêt pédagogique de Laveissière participe à la Journée internationale des Forêts
Cofor 15 | 10 Mars 2025
Défense des forêts contre l'incendie
Réunion d'Information sur le rôle de l’élu face au risque incendie en Haute-Loire
Cofor 43 | 28 Février 2025
Gestion forestière
Panneaux ONF-COFOR
Cofor AURA | 24 Février 2025